|
par Je suis née en mille neuf cent quarante-quatre. Une année avant la fin de la guerre. Une année avant le début du baby-boom. J’ai vécu la course folle à la rencontre de la statue de la Vierge que les autorités de l’Église promenaient dans les rues de mon village et des villages environnants pendant l’Année Sainte mille neuf cent cinquante. J’ai grandi sous la protection du Petit Jésus de Prague que maman idolâtrait. Durant ces années d’enfance j’ai surtout vécu la peur panique du « troisième secret de Fatima ». « Pauvre Canada », disait le pape Pie XII. Voilà pire que la menace d’une guerre nucléaire ! Pensionnaire à l’adolescence dans un couvent catholique tenu par des religieuses qui ont contribué à parfaire mon éducation de future parfaite épouse d’un bon catholique et de mère aimante d’une nombreuse progéniture. J’ai survécu aux levers à l’aube pour assister à la messe quotidienne à jeun pour communier, j’ai survécu à la pudeur maladive des bonnes sœurs qui nous obligeaient à nous laver sous la robe de nuit, j’ai survécu à la promiscuité des dortoirs occupés par une centaine de jeunes filles. J’ai appris à me servir d’une dactylo en même temps que le piano et la diction. Et j’ai trouvé à la bibliothèque du pensionnat, côtoyant les vies de saints et de saintes, quelques livres profanes qui ont meublé mes loisirs et m’ont permis de réaliser qu’il existait une vie en dehors de l’Église catholique. Adolescente, élève d’un collège classique pour jeunes filles, lorsqu’en philosophie j’ai voulu faire une recherche sur les écrits de Simone de Beauvoir, la directrice du collège a exigé que j’écrive à l’évêque de mon diocèse pour obtenir une permission spéciale afin de lever l’interdiction de lecture de ses livres. C’était en mille neuf cent soixante-quatre. Et pourtant une première femme, Marie-Claire Kirkland-Casgrain, avait déjà réussi à se faire élire à l’Assemblée nationale. Au milieu des années soixante, j’étudiais à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa. En droit criminel le professeur faisait toujours sortir systématiquement les rares filles de sa salle de cours lorsqu’il abordait les crimes à caractère sexuel. Nos chastes oreilles devaient, semble-t-il, éviter d’entendre les descriptions grivoises entourant les diverses formes d’agression sexuelle. En mille neuf cent soixante-huit, je n’ai eu d’autre choix qu’un mariage religieux, le mariage civil n’existait pas dans notre droit québécois. À cette occasion, j’ai juré fidélité et obéissance à mon époux puisqu’à cette époque au Québec, le mari détenait toujours la puissance maritale et l’autorité paternelle. Il occupait la fonction de chef de la famille et l’épouse devait habiter là où il fixait la résidence familiale. Je me souviens que notre professeur en droit de la famille affirmait sans rire que les femmes s’en trouvaient très bien puisque le mari « était tenu de l’y recevoir ». En d’autres mots, il ne peut la jeter dehors sauf s’il entreprend des démarches de divorce. Quel réconfort ! C’est dans la foulée de l’évolution du droit criminel par l’adoption du fameux Bill Omnibus libéralisant entre autres l’avortement et les relations homosexuelles entre adultes consentants que des études ont été entreprises pour reconnaître des droits aux femmes canadiennes. C’était l’époque de la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada à la fin des années soixante. Et moi, devenue juriste, je faisais carrière à l’Université Laval, j’aimais mon mari et je voulais des enfants. J’en ai eu, quatre, dont un seul, le dernier, avec congé de maternité défini dans notre première convention collective. Mais la société n’était pas encore prête à reconnaître à une mère le droit de faire carrière, mon mari s’est rangé du côté de l’opinion publique, mon mariage s’est effondré. Inexorablement, les Québécoises ont continué à accumuler des droits et se sont libérées du joug de l’Église et des mâles dominants de leur entourage, père, frères, oncles, mari. Planification des naissances, droit à l’avortement, congé de maternité, acquisition de l’autorité parentale qui remplace l’autorité paternelle, disparition de toute forme de puissance maritale laissant place à une égalité totale entre les époux, instauration de la prestation compensatoire visant à rétablir l’équilibre financier des époux au moment de la dissolution du mariage, et au début des années mille neuf cent quatre-vingt-dix, adoption de la notion de patrimoine familial. Mais la société tardait à suivre cette évolution juridique. Il a fallu du temps et de l’énergie pour lutter contre le machisme et le sexisme d’une société imprégnée si profondément des valeurs religieuses depuis la nuit des temps. Inlassables, les féministes ont travaillé ferme pour déconstruire le patriarcat, si catholique au fond. Et lorsque les églises se sont dépeuplées, les femmes ont commencé à prendre la place qui leur revenait. Elles travaillent toujours à bâtir une société basée sur l’égalité entre les sexes, une société juste, une société imprégnée de valeurs fondamentales de non-discrimination, une société laïque. Certes, nous n’y sommes pas tout à fait. Des femmes sont encore battues, violées, discriminées dans leurs lieux de travail, plusieurs assument seules la responsabilité des enfants, vieillissantes elles sont souvent isolées, malmenées, abusées. Elles ne représentent toujours qu’une infime portion de la classe politique et de la classe économique. Elles sont encore moins riches que les hommes. Les Québécoises sont parvenues à se libérer du joug de l’Église catholique. En général, les femmes ont les enfants qu’elles désirent au moment où elles le désirent, se marient ou vivent en couple avec qui elles veulent et, si elles le veulent, achètent en copropriété les biens de consommation importants, font carrière dans les domaines qu’elles choisissent. Ainsi moi, je suis mariée à une femme que j’aime. Depuis quelques années, les couples de même sexe ont acquis les droits qui leurs reviennent tout naturellement. Le droit de vivre en couple au grand jour, le droit de se marier, le droit de devenir parents. Le droit à l’indifférence, le droit de vivre tout simplement. Mais tout de même, je suis inquiète. Très inquiète. De plus en plus inquiète. Les débats actuels me questionnent au plus haut point. L’élection du parti conservateur au parlement canadien a ramené dans l’actualité la question de l’avortement. Les attaques viennent de toute part sur la question du statut du fœtus. Le regain pour la spiritualité religieuse me fait peur. Le discours des intégristes, des fondamentalistes de toute religion m’inquiète. L’utilisation à outrance des principes du multiculturalisme mis de l’avant par le Canada pour prôner les droits individuels au détriment des droits collectifs me fait entrevoir des lendemains pénibles pour mon Québec francophone, si différent avec ses valeurs de liberté, d’autonomie et de souveraineté. Devrai-je retourner dans la rue pour empêcher quiconque de nous enlever des droits ? D’en restreindre l’exercice ? J’appréhende ce que l’avenir réserve à mes petits-enfants. Pourront-ils vivre librement en profitant des luttes déjà menées et de celles actuelles ? Pourront-ils vivre pleinement dans une société laïque qui ne les contraint aucunement ? Ou au contraire devront-ils se battre pour réclamer des droits perdus ? Parfois j’ai bien peur que mon Québec ne retourne dans la Grande Noirceur. L’auteure Ann Robinson est professeure de droit à la retraite, et membre associée, Chaire Claire-Bonenfant, Femmes, Savoirs et Sociétés Mis en ligne sur Sisyphe, le 5 décembre 2013 http://sisyphe.org/spip.php?article4622 |
jeudi 5 décembre 2013
Montrez-moi une lesbienne féministe voilée
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
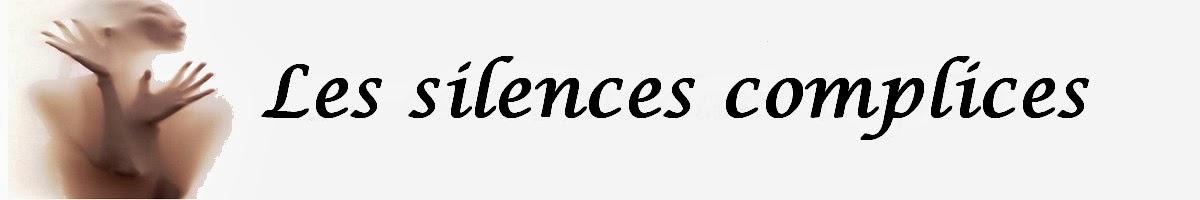
Aucun commentaire:
Publier un commentaire